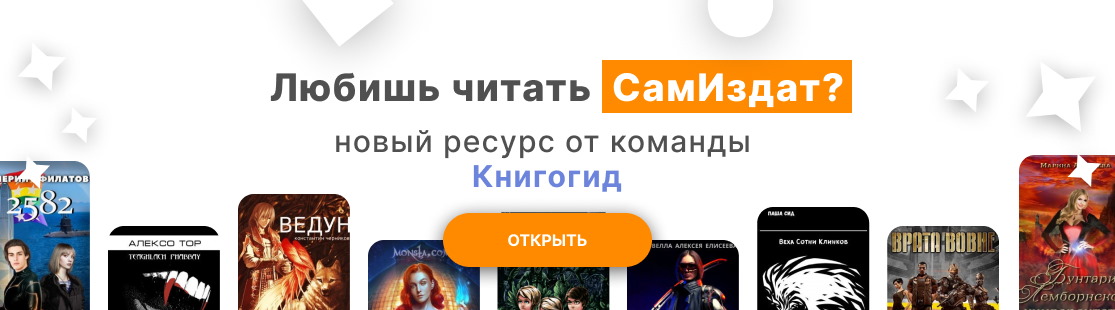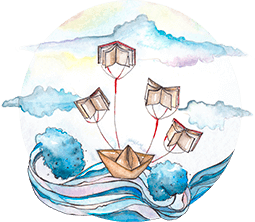Читать онлайн «La fille d'un heros de l'Union sovietique»
Автор Андрей Макин
Andreï Makine
La fille d'un héros de l'Union soviétique
1
Comme tout est fragile et étrange ici-bas…
C'est ainsi que sa vie n'avait tenu qu'à cet éclat de miroir terni et aux doigts bleuis par le froid d'une ambulancière mince comme une adolescente.
Il était couché dans ce champ printanier labouré par les chars, au milieu de centaines de capotes figées pendant la nuit en un monceau glacé. À gauche, d'un noir cratère, des poutres brisées hérissaient leurs pointes déchiquetées. Tout près, les roues enfoncées dans une tranchée à demi éboulée, un canon antichar se cabrait vers le ciel.
Avant la guerre, d'après les livres, il imaginait le champ de bataille tout à fait autrement: des soldats soigneusement alignés dans l'herbe tendre, comme s'ils avaient eu le temps, avant de mourir, de prendre une pose particulière, significative, suggérée par la mort. Chaque cadavre apparaissait ainsi dans la solitude de sa rencontre singulière avec la mort. Et l'on pouvait jeter un regard sur le visage de chacun d'eux, l'un tournant ses yeux vers les nuages qui s'éloignaient lentement, l'autre touchant de sa joue la terre noire.
C'est pourquoi, longeant pour la première fois le pré couvert de morts, il n'avait rien remarqué. Il marchait, tirant à grand-peine ses bottes des ornières du chemin d'automne, le regard fixé sur le dos de l'homme de devant, sur sa capote grise et délavée où brillaient des gouttelettes de brouillard.
Au moment où l'on sortait du village – squelettes d'isbas à demi brûlées – une voix s'éleva derrière, dans la file:
– Putain! Ils ne lésinent pas sur le peuple!
Il jeta alors un coup d'œil sur le pré qui fuyait vers le taillis voisin. Il vit dans l'herbe boueuse un amas de capotes grises où, pêle-mêle, gisaient des Russes et des Allemands, tantôt entremêlés, tantôt isolés, face contre terre. Puis quelque chose qui ne ressemblait plus à un corps humain, mais à une sorte de bouillie brunâtre, dans des lambeaux de drap mouillé.
Une de ces masses mortes, à présent, c'était lui. Il était couché; sa tête, prise dans une petite flaque de sang gelé sous la nuque, faisait avec son corps un angle inimaginable pour un être vivant.
Ses coudes étaient si violemment tendus sous son dos qu'il semblait vouloir s'arracher de terre. Le soleil scintillait à peine dans les broussailles givrées. Dans la forêt, à l'orée du champ et dans les entonnoirs, on discernait encore l'ombre violette du froid.Les ambulanciers étaient quatre: trois femmes, et un homme qui conduisait la fourgonnette dans laquelle ils déposaient les blessés.
Le front reculait à l'ouest. Le matin était incroyablement serein. Leurs voix, dans l'air glacé et ensoleillé, résonnaient, claires et lointaines. «Il faut terminer avant que ça fonde, sinon on va patauger!» Tous les quatre étaient à bout de fatigue. Leurs yeux, rouges de nuits sans sommeil, clignaient dans le soleil bas. Mais leur travail était efficace et bien coordonné. Ils pansaient les blessés, les chargeaient sur les brancards et lentement, faisant crisser les dentelles de glace, contournant les morts, trébuchant dans les ornières, ils parvenaient jusqu'au fourgon.